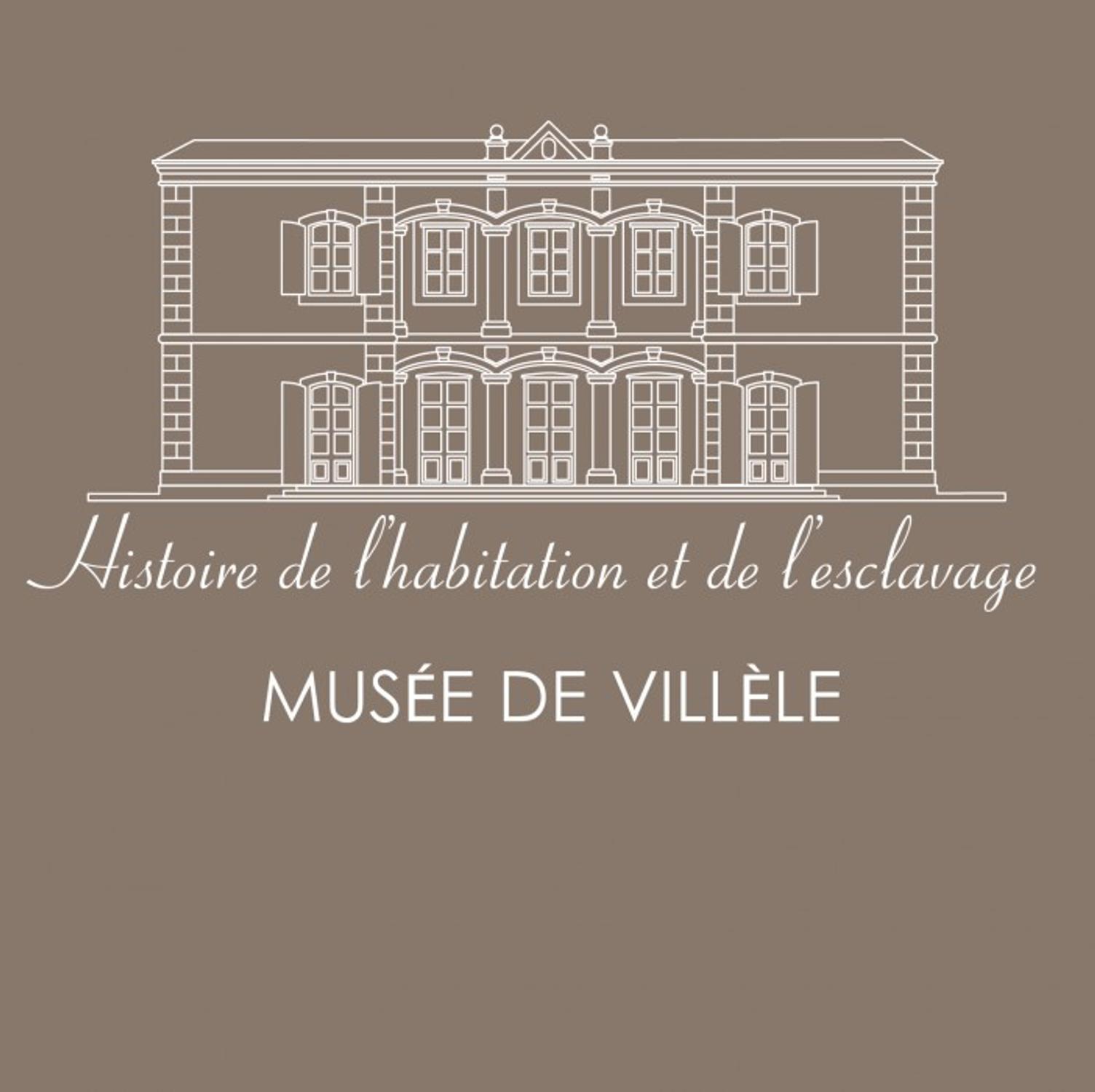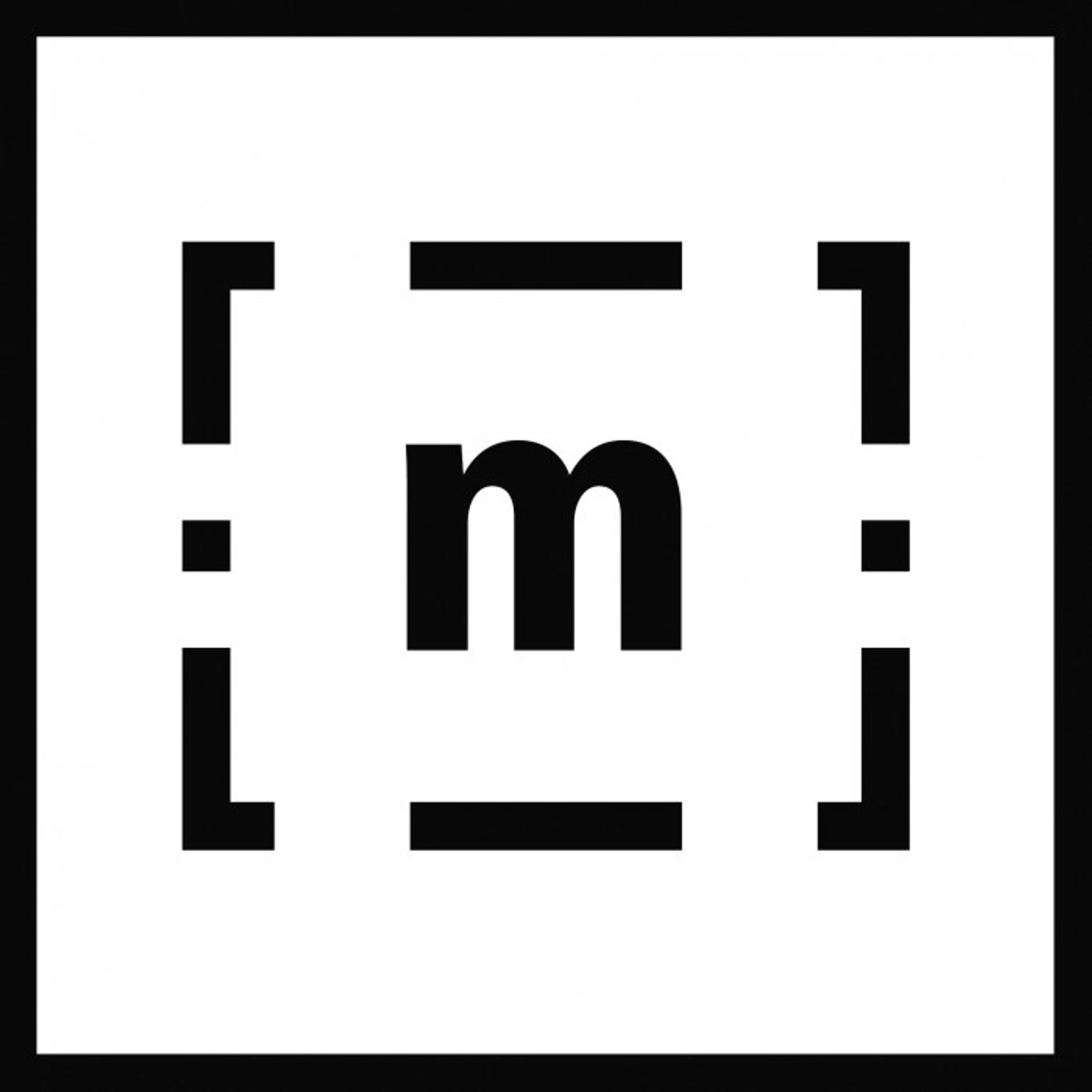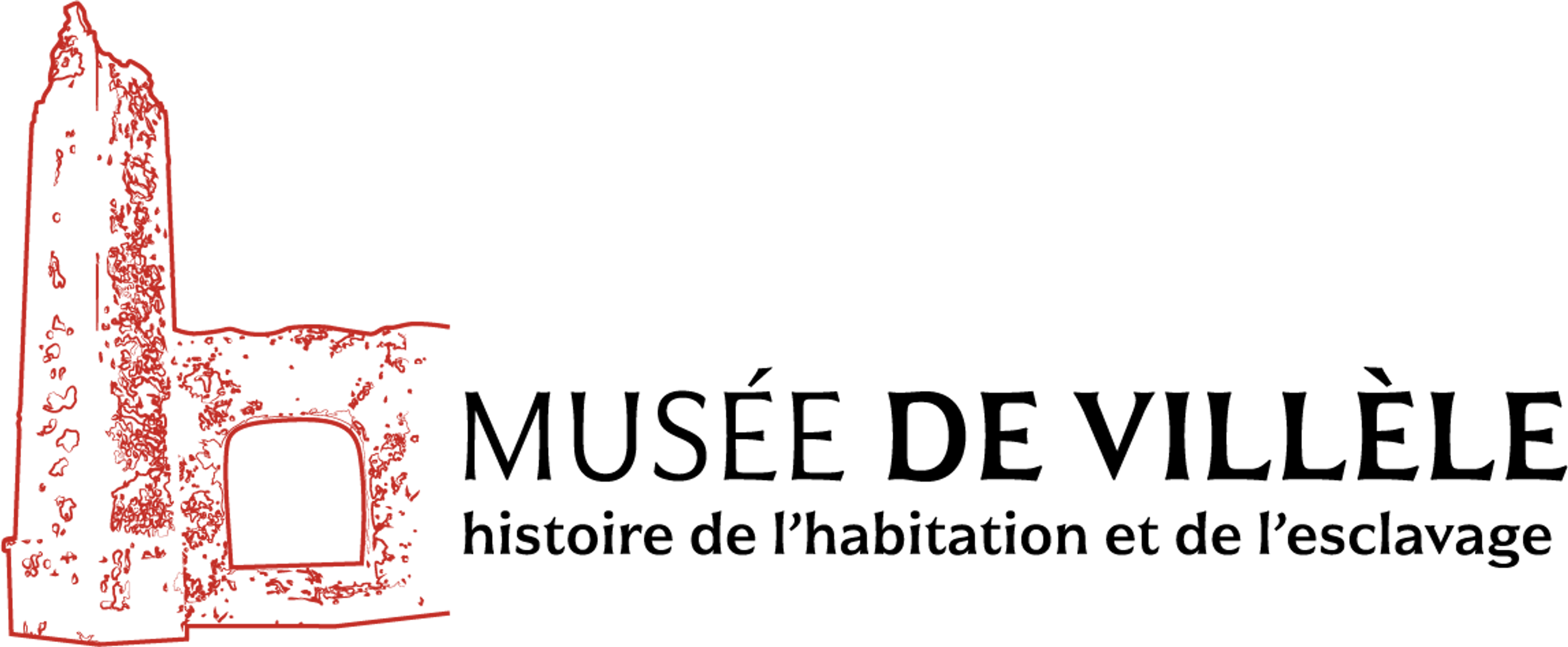Roulèr - Tambour à membrane
Numéro d'inventaire
2021.5.1
Désignation
Roulèr
Désignation
Tambour à membrane
Création/Exécution
Facture
2018
Auteur
Grondin Stéphane
La Réunion
Matière et technique
Bois de chêne
Peau de boeuf
métal
Mesures
Hauteur en cm : 70
Largeur en cm : 50
Domaine
Lutherie
Jeux - sports - loisirs
Description analytique
Appartenant à la famille des membranophones, le "roulèr" (anciennement rouleur) est un tambour tubulaire en forme de tonneau spécifique à La Réunion, car contrairement aux autres tambours de la zone, qui sont principalement des tambours sur cadre, celui-ci reste le seul à reposer horizontalement sur une cale nommée santyé. Il pourrait être l’héritage du tambour conique (tambour vouve ou tambour long) aujourd’hui disparu mais jadis représenté à La Réunion sur des iconographies et apparenté à l’atabaque de Madagascar (ayant survécu aux Seychelles sous le nom de tambour séga).
Aussi, il reste indéniable que le "roulèr" ou la percussion qui en a inspiré la création soit le fruit d’un métissage opéré au temps de l’esclavage à partir d’héritages africains. En guise d’illustration, nous retrouvons également en Guadeloupe, ancienne colonie française peuplée par des descendants d’esclaves africains, le même type de tambour appelé "ka". Il y a ainsi fort à penser qu’à la suite de leur arrivée sur l’île, les esclaves réunionnais aient confectionné des tambours quelque peu différents de ceux qu’ils avaient l’habitude de manier, dans la mesure où les matériaux à leur disposition n’étaient plus les mêmes. Pour cette raison, nous n’avons pas retrouvé de tambours identiques au roulèr sur le continent africain d’où il est pourtant originaire.
Le nom vernaculaire "rouleur" provient soit du mouvement des mains de l’instrumentiste, soit du déhanchement propre à la danse des Noirs (ancêtre du maloya). Cet instrument qui donne la base rythmique du maloya est traditionnellement fait à partir d’un tonneau tronqué à ses deux extrémités. L’une d’elle est recouverte d’une peau de bœuf tannée et cloutée. De nos jours, les barriques n’étant plus réellement importées sur l’île, les facteurs d’instruments se sont lancés dans des fabrications à partir de bois locaux comme le champac. Afin de permettre un accordage plus facile, sans avoir à chauffer la peau pour la tendre, ils ont aussi tendance à ligaturer la membrane par un système de cordage.
Joué à mains nues, le roulèr pouvait être percuté à l’aide d’une mailloche au 19e siècle, comme en témoignent les documents anciens. Dans ce cas, le musicien ne chevauchait pas l’instrument, alors qu’aujourd’hui cette posture lui permet d’accoler une jambe contre la peau de sorte à modifier la tension de celle-ci et obtenir une variation de timbre et de tonalité. (Texte de Fanie Précourt)
Propriétaire
Département de La Réunion
Gestionnaire
Musée de Villèle
© 2020, Jacques Kuyten
Facettes
Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.