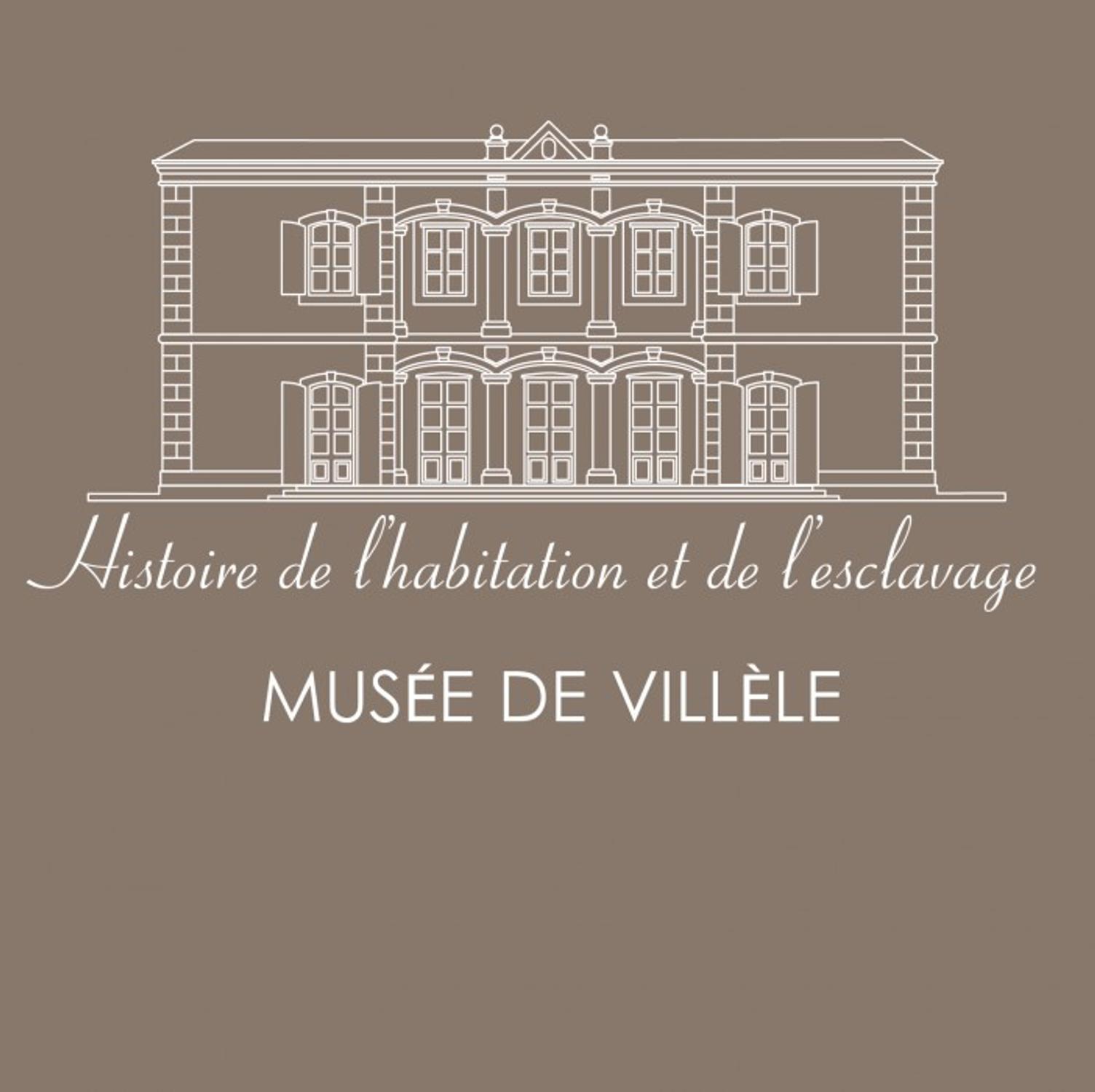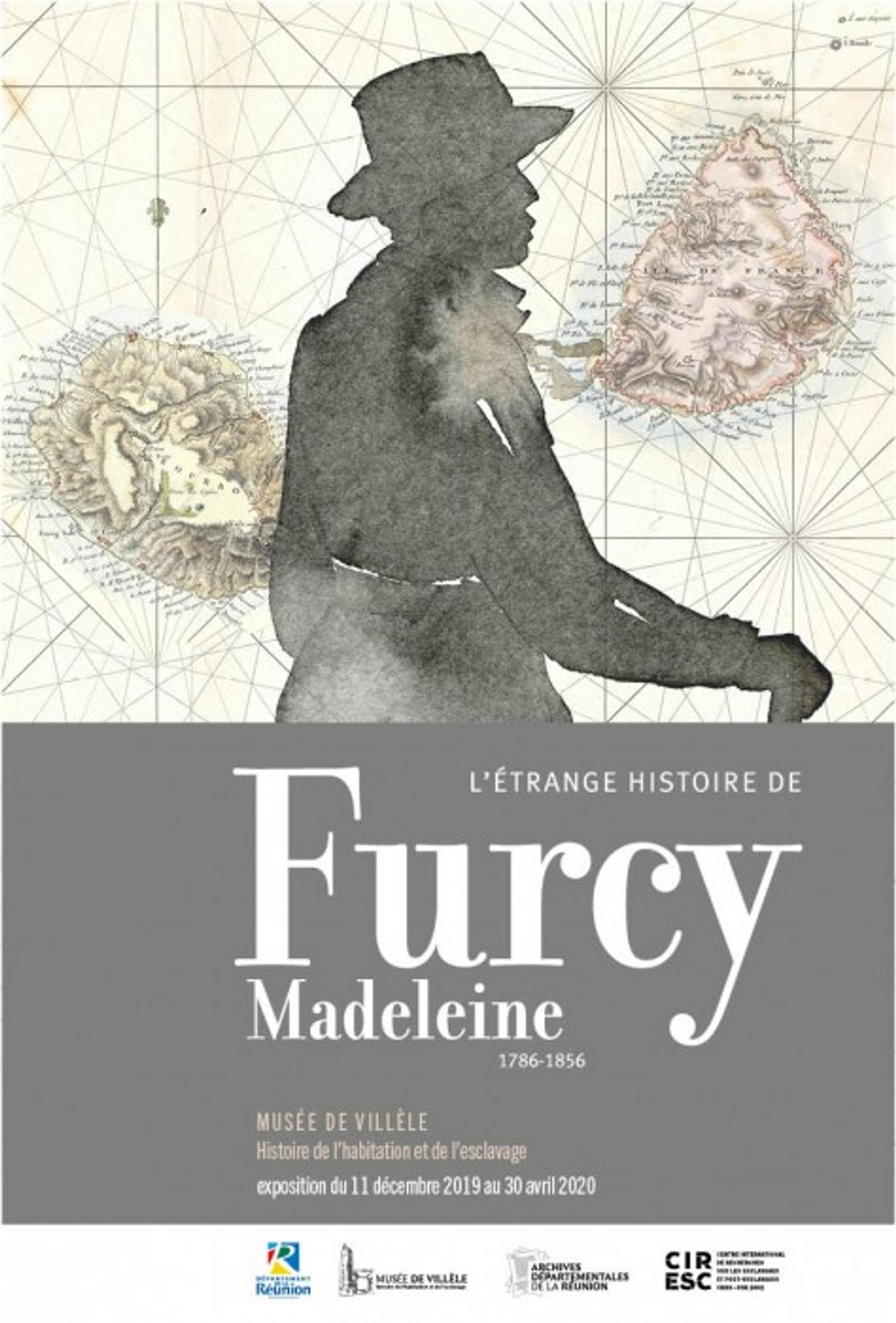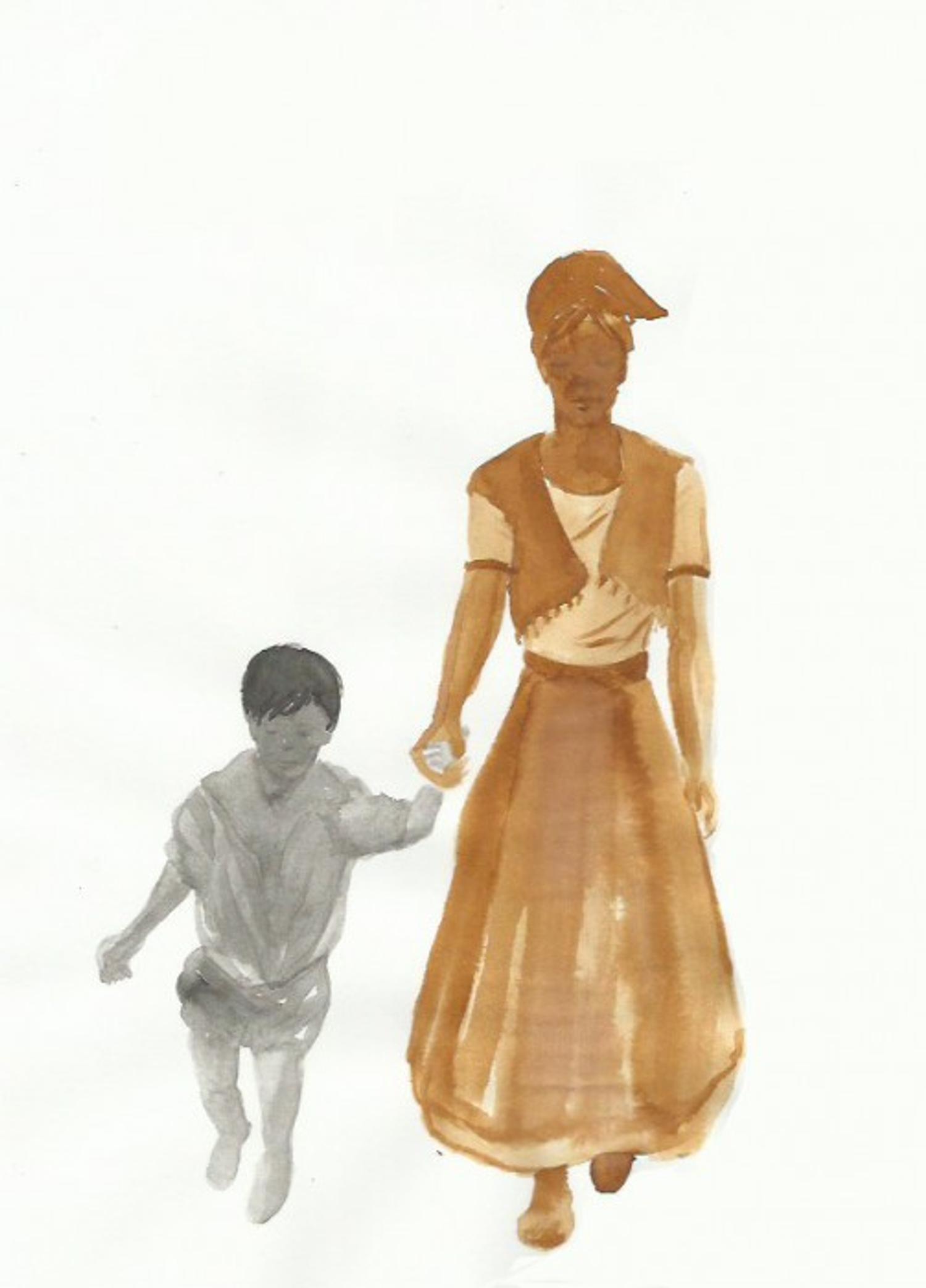L'étrange histoire de Furcy Madeleine, 1786-1856
10 décembre 2019 - 30 novembre 2020 / Musée historique de Villèle - étage de la maison
Vidéos : Furcy aujourd'hui
Mohammed Aïssaoui Laffaire de lesclave Furcy
Johary Ravaloson
Kaf Malbar
Laurent Médéa
Marco Ah Kiem
Co-comissariat : Gilles Gérard, docteur en anthropologie et en histoire / Jean Barbier, conservateur en chef du msée de Villèle.
Comité scientifique : Damien Vaisse, conservateur des Archives départementales de La Réunion ainsi que Lise Di Pietro, adjointe au conservateur / Sue Peabody et Jérémy Boutier, historiens .
En 1817, l’esclave Furcy, âgé de 30 ans, décide de partir de chez son maître Joseph Lory. Il se prétend libre et engage un long combat afin que la justice reconnaisse sa condition d’homme né libre d’une mère indienne.
Au cours de son procès s’opposent ses défenseurs, le procureur général Louis Gilbert Boucher et le substitut du procureur du roi, Jacques Sully-Brunet, au commissaire ordonnateur général de la colonie, Philippe Richemont Desbassayns, troisième fils d’Henri-Paulin et Ombline Desbassayns.
Furcy perd son procès à la cour royale de Bourbon en décembre 1817 puis en appel. Après plusieurs années durant lesquelles il est exilé à l’île Maurice par son maître, il obtient un pourvoi en cassation par la cour royale de Paris qui déclare en 1843 qu’il est un homme libre de naissance.
À La Réunion, Furcy est devenu un symbole de la lutte pour la liberté.
La conception de l’exposition
L’exposition est organisée en partenariat par le musée de Villèle en lien avec les Archives départementales de La Réunion. Elle est l’aboutissement des travaux de recherche menés par l’anthropologue et historien Gilles Gérard qui en a écrit le scénario.
Elle s’appuie également sur les travaux de Sue Peabody, historienne et universitaire américaine, auteure de Madeleine’s Children: Family, Freedom, Secrets, and Lies in France’s Indian Ocean Colonies et du chercheur Jérémy Boutier, auteur d’une thèse sur la question de l’assimilation politico-juridique de La Réunion à la métropole, 1815-1906 (Université d’Aix-Marseille) et de plusieurs articles sur Furcy. Aujourd’hui, l’affaire Furcy est traitée comme un cas d’école dans le domaine judiciaire et est étudiée dans les cursus universitaires de droit.
Les résonances contemporaines de l’affaire Furcy
A La Réunion, si l’histoire de Furcy nous est révélée par les travaux de l’historien Hubert Gerbeau en 1990, c’est cependant grâce à Sophie Bazin et Johary Ravaloson (alias Arius et Mary Batiskaf), et leur création Liberté Plastik en 1998 que Furcy est devenu un symbole de la lutte pour la liberté.
La publication du livre de Mohammed Aïssaoui, L’affaire de l’esclave Furcy (Prix Renaudot 2010), est un autre élément à prendre en compte pour comprendre l’apparition dans les années 2000 du mouvement collectif Libèr nout’ Furcy, et l’émergence de diverses créations d’artistes d’ici et d’ailleurs : les pièces de théâtre d’Hassane Kouyaté, L’affaire de l’esclave Furcy , de Francky Lauret et Erick Isana, Fer6, le film d’animation de Laurent Médéa, la chanson L’or de Furcy du musicien Kaf Malbar, ou bien encore la sculpture de Marco Ah Kiem au Barachois à Saint-Denis.
Enjeux de l’exposition
L’exposition a pour ambition, à partir des sources disponibles, de donner à connaître la vie de Furcy, dans sa dimension singulière, prodigieuse et complexe, quitte à rétablir des faits et à briser quelques a priori : il n’a pas été un militant abolitionniste, il possèdera lui aussi des esclaves et finira ses jours dans une relative opulence.
Elle a aussi pour objet de replacer l’étrange histoire de Furcy dans le contexte des sociétés coloniales de Bourbon et de Maurice et de mettre en lumière une représentation de Furcy, souvent déformée, dans la mémoire collective.
Le parcours de visite est rythmé par les différents événements de ce combat juridique de 27 années : abus de pouvoir, faux documents, pressions exercées sur Furcy et sur sa famille…
Des pièces d’archives pour chacune des quatre sections de l’exposition, sont mises en avant pour étayer le propos des historiens et des fiches de salle sont consultables pour approfondir des notions ou des faits.
Traité en parallèle dans un second parcours intitulé « Furcy aujourd’hui », un dispositif d’écrans diffuse des interviews des nombreux artistes qui se sont emparés ces dernières années de l’histoire de Furcy.
Les personnages créés par le dessinateur Sébastien Sailly sous forme de silhouettes, sont présents dans toutes les salles pour aider le visiteur à resituer tous les protagonistes du récit dont la trame se déroule entre l’Inde, Bourbon, Maurice et la France : Furcy dont aucune représentation n’est connue à ce jour, sa soeur Constance, libre de couleur, sa mère Madeleine née à Chandernagor, Philippe Desbassayns de Richemont, fils d’Ombline Desbassayns, le procureur Boucher, Joseph Lory, maître de Furcy…
Des personnages, des lieux, des documents perdus et retrouvés, des documents maquillés : tous les éléments sont en place pour transformer le visiteur en enquêteur.
Le fonds Furcy aux Archives départementales de La Réunion
C’est en 2005 que la centaine de documents de « l’affaire concernant l’esclave Furcy » qui correspond en fait aux papiers de Louis Gilbert Boucher, procureur général de la cour royale de Bourbon, principal soutien de Furcy. …a intégré les archives de La Réunion. Mis aux enchères à l’hôtel Drouot, ce fonds a été acheté par le Conseil départemental de La Réunion. La recherche historique sur Furcy a progressé notamment grâce à l’achat de ce fonds qui comprend lettres, comptes rendus d’audience judiciaire, plaidoiries.