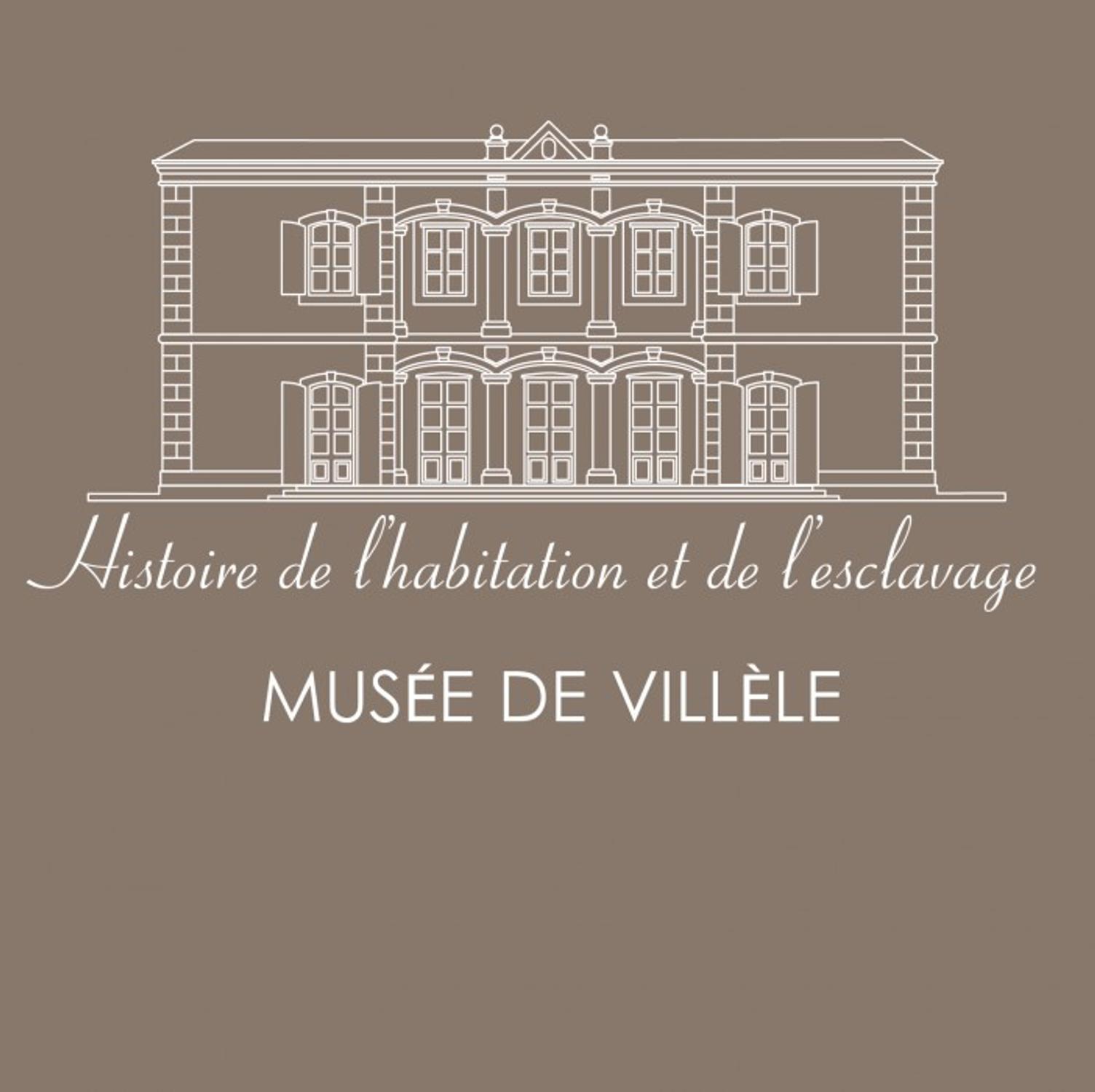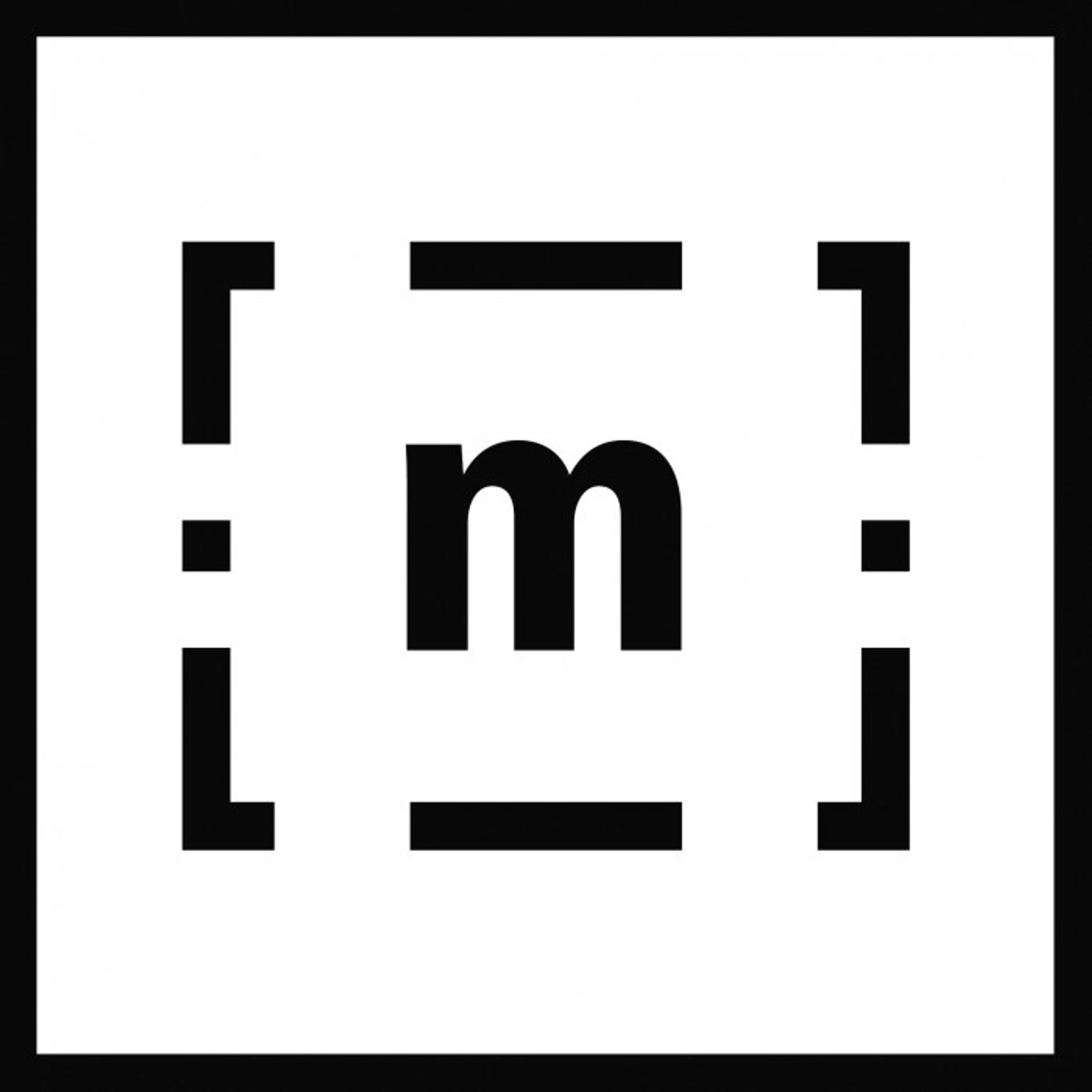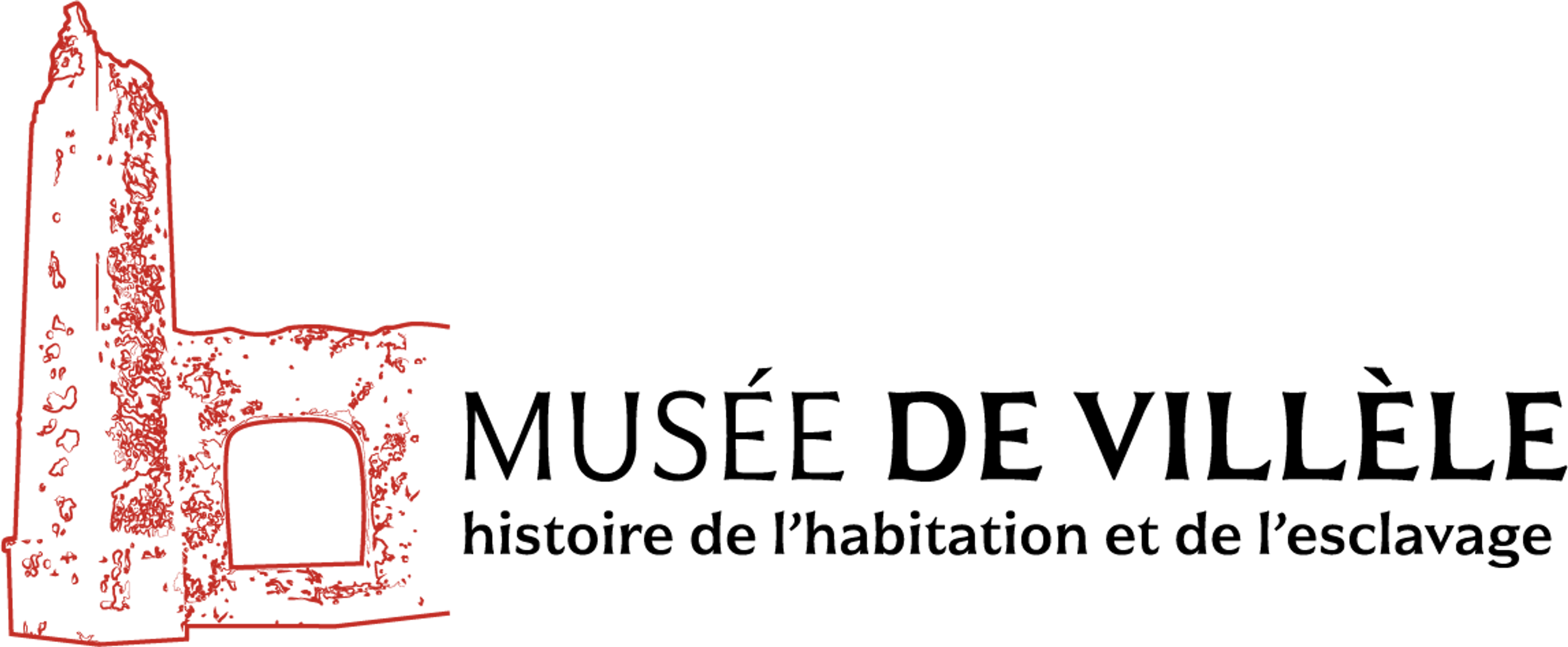Site des environs de la rivière d'Abord - Saint-Pierre
Numéro d'inventaire
1992.147.4
Désignation
Site des environs de la rivière d'Abord
Création/Exécution
Dessinateur
; 1801
; La Réunion
Auteur
Bory de Saint-Vincent Jean-Baptiste Geneviève Marcellin
- Date de naissance1778
- Lieu de décèsParis
- Date de décès1846
- Nationalité / CultureFrançaise
D'après
; peintre
; 4e quart 18e siècle
Auteur
Patu de Rosemont Jean-Joseph
- Date de naissance1766
- Date de décès1818
- Nationalité / CultureFrançaise
Graveur
; 1er quart 19e siècle
Auteur
Fortier
Graveur
; 1er quart 19e siècle
Auteur
Adam
Imprimeur
; 1804
; Paris
Auteur
F. Buisson
Matière et technique
Eau-forte
; Papier
Mesures
Hauteur en cm : 26,5
; Largeur en cm : 36,5
Domaine
Estampe
Inscriptions / marques
Numérotation
; h. d.
; Pl. XL
Description analytique
Bory de St-Vincent effectue un voyage de reconnaissance géographique à bord de la corvette Le Géographe. Il réside tout d'abord à l'île de France et ensuite à Ile de la Réunion du 12 août au 5 décembre 1801 avant de retourner en France. En 1804, il publie la relation de son séjour sous le titre Voyage dans les quatre principales îles des mer d'Afrique, Fait par ordre du gouvernement pendant les années neuf et dix de la République (1801-1802) imprimé par F. Buisson à Paris en 1804. Les trois volumes de texte sont accompagnés d'un atlas de planches.
Quand Bory de Saint-Vincent débarque à l'île de France en mars 1801, il offre ses services au gouverneur, le général Magallon de la Morlière, qui l'envoie à La Réunion. Bory de Saint-Vincent passe quelques mois à visiter l'île et dessine les sites les plus pittoresques de l'île.
Dans son récit qui accompagne l'atlas, Bory de Saint-Vincent relate sa visite chez le peintre de paysage Jean-Joseph Patu de Rosemond. Il avoue avoir copié certaines oeuvres de cet artiste afin d'illustrer son ouvrage.
Cette planche n° XL représente l'une des rares images dont le sujet central est l'esclavage, à travers la représentation d'une scène familiale campée dans un environnement végétal où il est aisé de reconnaître des bananiers, des pandanus aux fruits si caractéristiques et des papayers aux troncs courbés. Le linge sur les épaules de l'homme qui tient dans ses bras un enfant, évoque certaines tenues traditionnelles de Madagascar, en particulier le fameux lamba, grande toile de coton tissé tenant lieu à la fois de couverture et de vêtement. Les conditions de vie sont également montrées à travers l'habitation constituée d'une paillotte en bois et de matériaux végétaux et d'une autre petite construction de même type, située à proximité, faisant sans doute office de cuisine.
On peut toutefois émettre quelques réserves devant cette représentation idéalisée de l'esclavage. En effet, il est rare d'avoir une cellule familiale d'esclaves composée des deux parents et de plusieurs enfants. La femme élève ses enfants seule dans la plupart des cas et surtout tente d'en avoir le moins possible.
Bibliographie
F. Buisson
Somogy
; p.136
Australe éd.
; p.76
Propriétaire
Département de La Réunion
Gestionnaire
Musée de Villèle
© 2017, Jean-Pierre Woaye-Hune, Musée de Villèle
Facettes
Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.
- Bory de Saint-Vincent Jean-Baptiste Geneviève Marcellin
- Patu de Rosemont Jean-Joseph
- F. Buisson
- Fortier
- Adam
- 18e siècle
- Ere chrétienne
- 2e moitié 18e siècle
- 19e siècle
- 1ère moitié 19e siècle
- 1er quart 19e siècle
- 4e quart 18e siècle
- 1801
- 1804
- Estampe
- Musée historique de Villèle
- France
- Europe
- Iles du Sud-Ouest de l'océan Indien
- Afrique noire
- Afrique
- Paris
- Ile-de-France
- La Réunion
- Mascareignes
- Afrique noire
- Afrique
- La Réunion
- Mascareignes
- Saint-Pierre
- Genre de la représentation
- Mots clés
- Société
- Société et vie sociale
- Végétal
- La nature
- Le corps et la vie matérielle
- Grandes thématiques
- Architecture
- Iconographie et histoire de La Réunion
- Plante
- Espèce végétale
- Paysage
- Edifice d'habitation
- Architecture d'habitation
- Famille
- Statut social
- Esclave
- Esclavage
- Ordre social
- Histoire générale de l'esclavage
- Esclavage
- Paillote
- Abri
- Pandanus
- Plante exotique
- Bananier
- Papier
- Matériau d'origine végétale
- Matériau
- Estampe
- Eau-forte
- Utilisation de vernis et d'acide
- Taille-douce