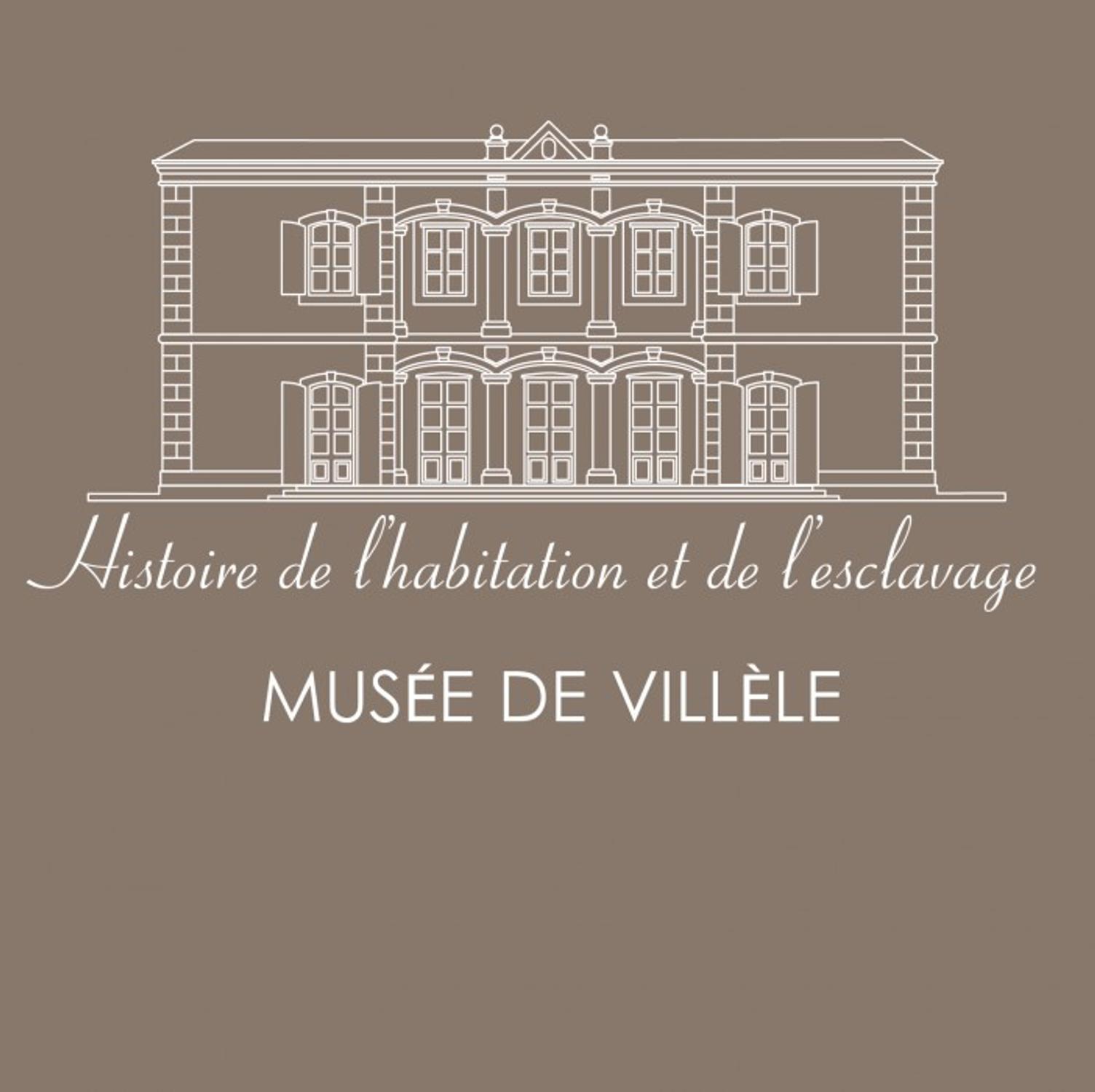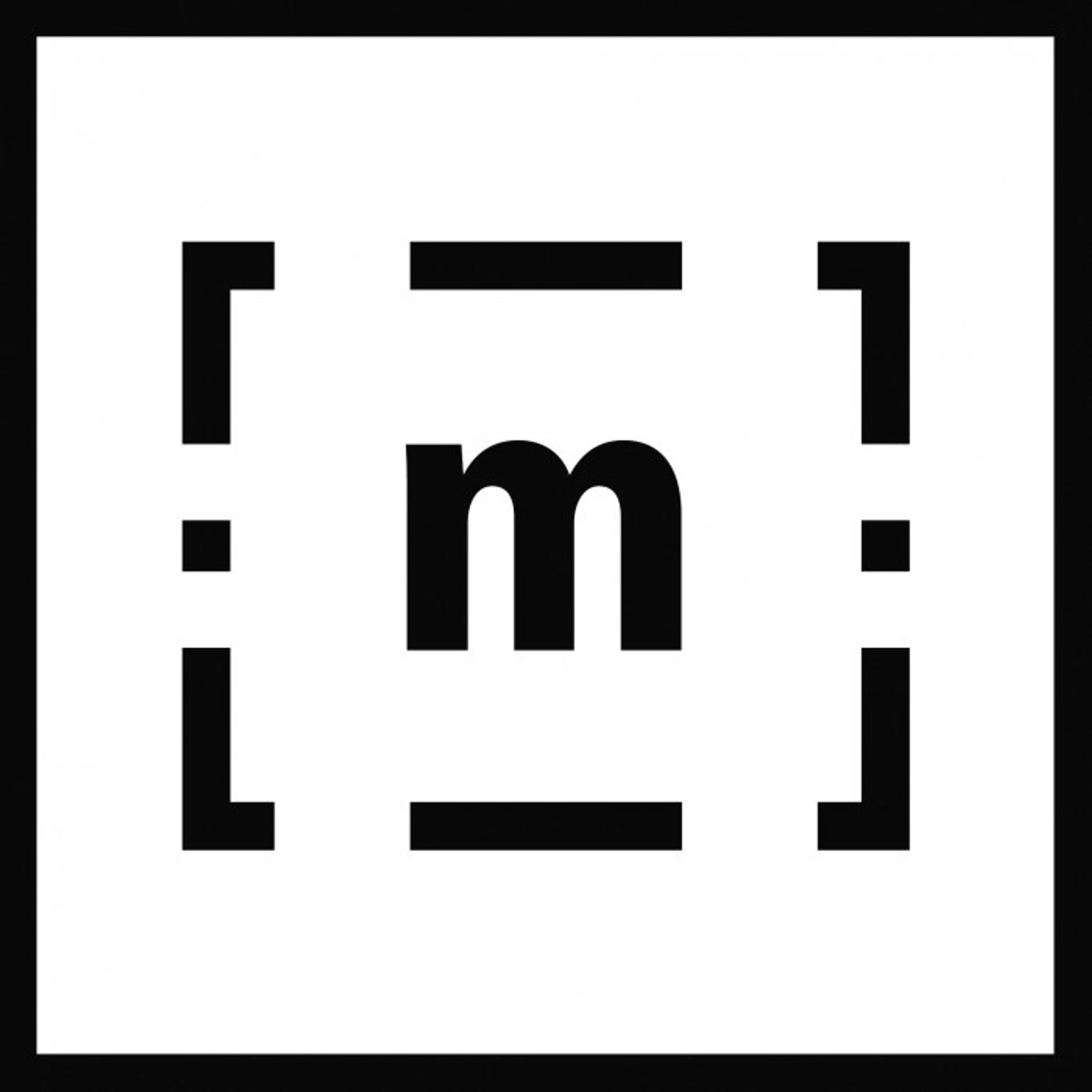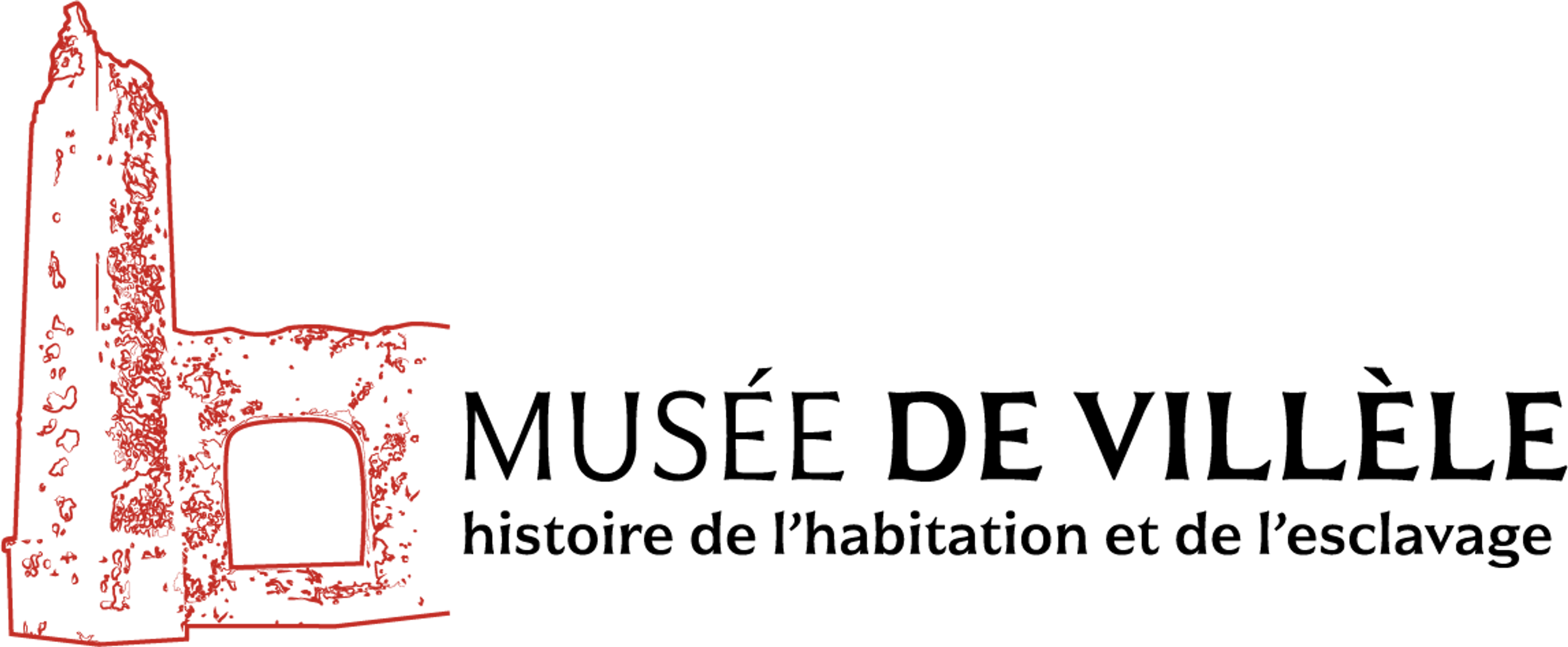Bobre; baguette; hochet - Arc musical
Numéro d'inventaire
2021.4.1
Désignation
Bobre; baguette; hochet
Désignation
Arc musical
Création/Exécution
Facture
2018
Auteur
Johny Bily
La Réunion
Matière et technique
Calebasse
Bois jaune
Fibre de choca
Bois de gaulette
Feuille de pandanus
Graine de conflore
Mesures
Hauteur en cm : 184
Largeur en cm : 70
Domaine
Lutherie
Jeux - sports - loisirs
Description analytique
Ce cordophone monocorde avec résonateur, comparable au "berimbao" du Brésil, se retrouve sur différentes îles de l’océan Indien, telles qu’à Maurice et à Rodrigues (se nommant "bom"), à Mayotte ("dzendze lava") et aux Seychelles ("bonm"). Il pourrait être originaire de Madagascar, où il s’appelle "jejilava", et aurait jadis été disséminé, comme bon nombre d’instruments traditionnels, à travers la zone grâce à la population serville immigrée de la Grande île. Cela dit, on le retrouve également au Mozambique, où ce principe d’arc musical avec résonateur existe sous les noms de "chitende", "n’thundao" ou "chiqueane" (au sud de Rio Save), et "chimatende" (dans la province de Sofala).
Selon l’ethnomusicologue Jean-Pierre La Selve, le nom vernaculaire « bob » (anciennement bobre) spécifique aujourd’hui à La Réunion, pourrait provenir d’Europe : « L’arc musical rappelle en effet un instrument souvent représenté dans la peinture flamande, le bumbass, monocorde dont le résonateur est une vessie de porc séchée, et qui était utilisée en Europe du Nord comme instrument de carnaval. Il n’est donc pas exclu que des marins flamands [aient] pu introduire ce nom qui par suppression de la dernière syllabe peut passer de bumbass à bomb, puis de la à bom. » (1)
Aussi, l’iconographie d’époque, montrant des similitudes entre les résonateurs des instruments européens et des premiers modèles réunionnais faits de vessie, abonde dans le sens d’une origine européenne.
Retrouver la provenance du bobre (devenu bob) n’est pas aisée, car fruit d’un syncrétisme, sa facture instrumentale tout comme son utilisation a évolué depuis son arrivée sur l’île. La vessie animalière servant d’amplificateur s’est transformée en calebasse évidée et coupée aux deux tiers, en passant par la boîte de fer blanc. La corde autrefois végétale est devenue un fil d’acier, un câble d’électricité ou de frein de vélo. L’archet, fait d’une branche incurvée par la tension de crins de chevaux, a laissé place à la baguette d’une trentaine de centimètres batavek, également nommée tikouti (ou à défaut à une pièce de monnaie), qui percute l’instrument. Le hochet kaskavel, traditionnellement tenu par la main droite de l’instrumentiste (pour un droitier) et constitué d’une enveloppe végétale tressée enfermant des grenailles (safran maron, job...), s’est aujourd’hui raréfié.
La technique de jeu consiste, pour le musicien qui accole par alternance la calebasse contre son torse ou son ventre (la hauteur du résonateur fixé sur le manche dépendant de l’accordage souhaité), à frapper la corde. Tenant l’arc au niveau du résonateur, les doigts de l’instrumentiste peuvent aussi influer sur les sonorités par la tension de la corde. Joué à des fins mélodico-rythmiques en solo pour les complaintes et "maloya pléré", ou au sein de l’effectif instrumental propre au maloya festifs (anciennement danse des Noirs), le bobre était aussi l’apanage des marionnettistes ambulants jusqu’au début du xx e siècle. (Texte : Fanie Précourt)
1. La Selve, Jean-Pierre, "Musiques traditionnelles de La Réunion", Saint -Denis, Azalées 1995, (p.54).
Propriétaire
Département de La Réunion
Gestionnaire
Musée de Villèle
© 2020, Jacques Kuyten
Facettes
Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.